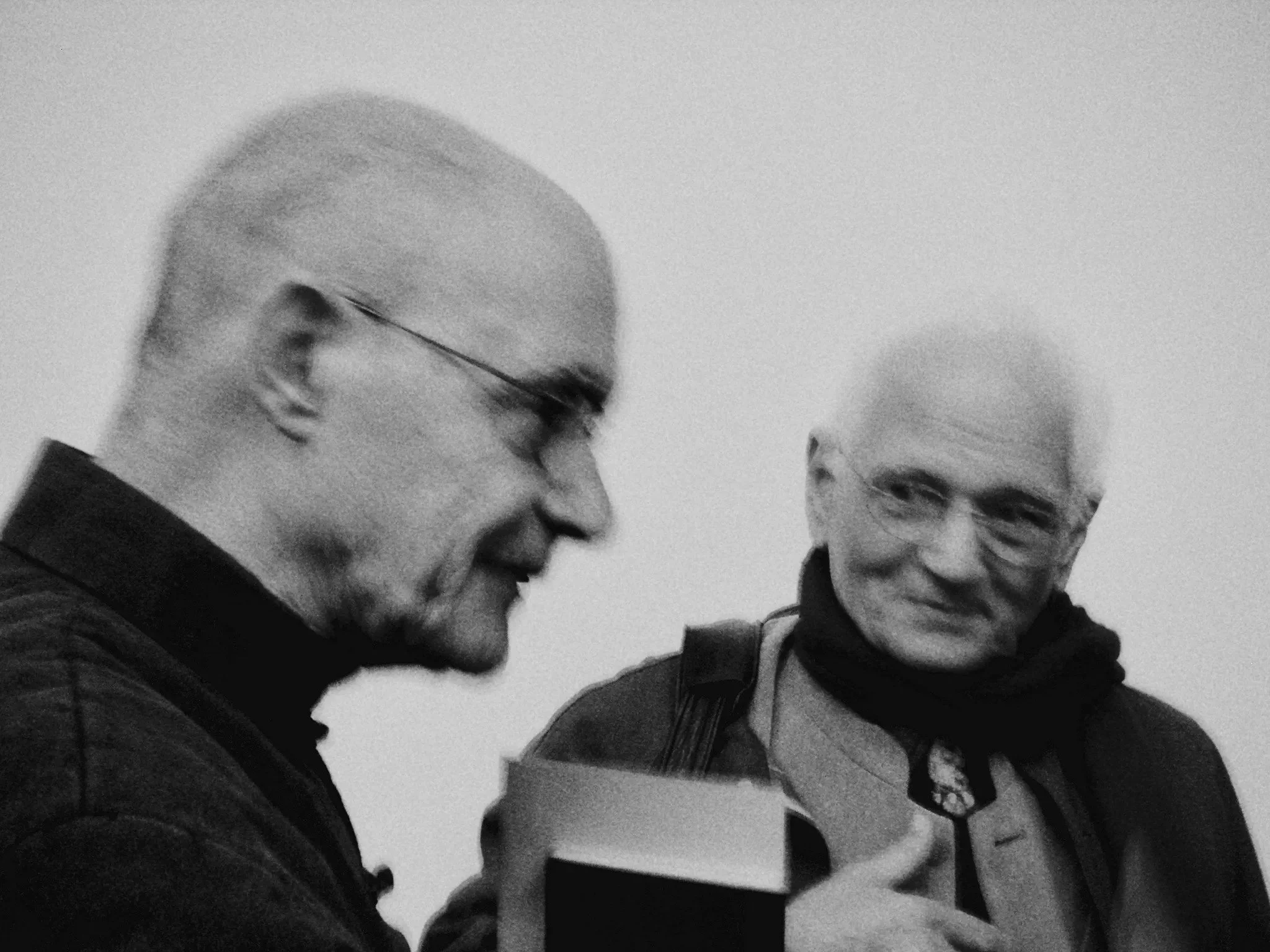il n’y a rien entre nous
Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy : amis, avec philosophie
L’un se nomme Jacques Derrida, l’autre Jean-Luc Nancy : ils étaient amis, avec philosophie. D'une amitié où se croisent, sans se couper, la parole et le fil de l'esprit.
Il faut garder en tête que tous deux longent le continent Martin Heidegger, et l’archipel, tout aussi amical, d’Emmanuel Levinas, de Georges Bataille et de Maurice Blanchot. Dans les années 1960-70, ces noms innervent l’oeuvre de Jacques Derrida (et Jean-Luc Nancy en suivant) où fleurit une notion, qu'il a moins portée qu'on ne la choisie pour lui et qu'il a toujours appelée à déconstruire. Oui, il n’y a que des déconstructions, si l'on y tient, qui ne sont ni destruction ni reconstruction (1) mais affirmation. De quoi battre en brèche la peur de certain·es qui pourtant ne manquent pas de parer leur propre épouvantail : « le déconstructionnisme ». Il est effectivement plus aisé de rester à distance de reproche vis-à-vis du doute philosophique, que d’en assumer le tâtonnement bouleversant. Déconstructions, donc : respectueuses imprudences pour désobstruer les ambiguïtés inquiétantes, tenues sous silence du bon sens commun, aurait assumé Jacques Derrida. Et ce, notamment, à propos de la relation d’un, de dix ou mille je à un nous. Ce questionnement l'habite, ainsi que Jean-Luc Nancy, alors que les notions de communauté, de fraternité, d’État-nation ou de peuple sont mises à l'épreuve de l’histoire (totalitarismes, impérialismes et guerres coloniales, pour exemple).
Il n’y a rien entre nous, aime à dire Jean-Luc Nancy dans sa philosophie sur ce même thème. C’est donc qu’il y a, peut-être, entre eux deux, et entre chacun de nous, un rien qui nous rapproche ; qui, peut-être, déclos et éclos ce nous si nous avions à en être un.
Nous — dit je.
Voilà, une bien anodine et confondante première personne du pluriel, qui n’en donne pas moins à penser. Il faut en venir à la linguistique pour se rendre sensible tout d'abord à l’approche derridienne. Tout part d'ici. Le nous à deux visages : soit inclusif (il rassemble l’instance locutrice, les destinataires et les autres auditeur·ices) soit exclusif (il discrimine les destinataires, et tout autre individu, vis-à-vis de l'instance locutrice). Jacques Derrida explicite ainsi que derrière les deux faces du nous, tout aussi inclusif soit-il, présuppose une ouverture conditionnée à un référent interne, et pour cela à une identité, c’est-à-dire : celle de l’instance locutrice avec elle-même, dans une tonalité exclusive ; celle de l’instance destinataire avec elle-même, pour ce qui est de l'inclusive. Aussi, Jacques Derrida, appuyé par les travaux du linguiste Emile Benveniste, souligne-t-il combien c’est se méprendre que d’observer le nous comme une association libre d’individus singuliers, différents et, dès lors, dissociables. Emile Benveniste souligne, en effet, la mono-référentialité incontournable du je. Or, le nous, avance Jacques Derrida, n’est en réalité que la reproduction en nombre de ce je. Il pluralise, au sens où il étend, et ce, plus ou moins largement selon qu’il soit exclusif ou inclusif, c'est entendu. C’est donc avec méfiance, que Jacques Derrida regarde ce pronom agglomérant et confondant, d’autant plus s’il est conjugué à une portée politique (communauté, peuple, nation...). Il ne faut pas oublier que celui-ci fait l'expérience de cette difficulté, sinon impossibilité, de savoir à quel nous appartenir : celui de l’Algérie, de la France ou encore de la communauté juive.
En tant qu’individu, il ne saurait choisir, sinon poussé et contraint par la domination de l’un de ces nous sur les autres.
Ce que, bien sûr, il critique. De son côté, Jean-Luc Nancy, n'est pas davantage un fervent défenseur du nous. Il prend tout autant ses distances et ne l’aborde pas en lui-même, pour lui-même. Lorsqu’il le questionne, c’est toujours avec la nuance d'un adjectif. De là, cet entre nous nancéen qui ne peut plus se confondre avec le nous. Cet qualité de l’entre, il l'affirme comme la condition d’ouverture véritable du nous contre ses élans de totalisation mono-référentielle et de domination identitaire. Dans ce nouveau nous, pour Jean-Luc Nancy, il ne s’agit plus du commun confondant et niant les individualités, ni d'un tout prévalant sur des parties insignifiantes. Il s’agit, grâce à cet entre, de ce qui est en partage, seulement et simplement, entre des singularités librement associées. Voilà qui est loin d’un nous semblable à la nation, en tant que fusion non choisie — du fait qu'elle précède toujours la naissance de ses membres et de leurs propres volontés. Jean-Luc Nancy aurait-il sauvé le nous ? C'est par la négative que répond pourtant Jacques Derrida, car cet entre nous n’en demeure pas moins fondé sur ce pronom. De fait, il ne contrevient qu'en apparence au nous en tant qu’il est un je au pluriel. Jacques Derrida s'amuserait ainsi à dire que de l’entre nous à l’entre-nous, et de l’entre-nous à l’entre-soi, il n'y a pas loin. Il faut donc encore trouver un moyen d'y voir plus clair.
Evelyne Grossman propose de placer Jacques Derrida dans la tradition de l’être-avec et Jean-Luc Nancy dans celle de l’être-ensemble. Toutefois, je propose de prendre le temps de nuancer cette articulation. En effet, faire de Jean-Luc Nancy un penseur de l’être-ensemble, aux côtés de Maurice Blanchot, manque, je crois, la médiateté du nous nancéen. Jean-Luc Nancy s’est d’ailleurs lui-même distingué de l’être-ensemble. En ce que ce concept appelle un être-commun, qui, trop menaçant encore de fusion, implique une existence par l’ensemble : sans place pour la singularité, sans entre-deux possible. Autrement-dit, il renoue avec la re-semblance confondante du seul nous. Jean-Luc Nancy préfère donc traiter de l’être-en-commun. Aussi, l’en est-il au commun ce que l'entre est au nous nancéen : un dilatement intérieur, qui permet de prendre ses distances avec l’ensemble, tout en y restant. L’en est cette respiration qui articule l’être et le commun en se gardant de les confondre. Jean-Luc Nancy est donc le penseur d'un co-présence — dont il hérite de Georges Bataille — plus encore que de l’être-ensemble. Ce simple préfixe “co-” convie l’incomplétude de l’individu, à rebours du parfait accomplissement dudit ensemble. Cet individu, il prend soin de le définir comme singulier pluriel, singulier et pluriel. Aussi, Jean-Luc Nancy affirme-t-il que l’ « avec est le premier trait de l’être » (Nancy, 1996 : 76).
Être avec toi, cela implique aussi que je sois libre de ne pas être avec toi. Nous ne sommes pas ensemble, de force et confondus, mais toi et moi nous côtoyons librement parce que nous avons des points communs, seulement des points en commun.
C’est ainsi que je, tu et nous parviennent à co-exister chez Jean-Luc Nancy. Aussi, le différend avec son ami ne s’opère-t-il pas autour de l’être-avec en lui-même, mais bien à propos de sa conception. En réalité, il y a de l'un à l’autre une variation sur ce thème philosophique de l’être-avec. Le premier essaye de le penser hors de tout nous, le second se permet de le penser à l’aune de l’entre nous.
L’espace de friction de pensée qui se noue entre les deux philosophes sur ce point, se déplace, dès lors, sur la tentative de re-légitimation du nous par l'entre nancéen, et la distance qu’il préserverait dans l’appartenance. Je l'ai dit, l’entre nous laisse planer aux yeux de Jacques Derrida l’idée-même du nous, de sa possibilité. À cela, la formule de Jean-Luc Nancy réplique que cet entre est un rien (« il n’y a rien entre nous »), et, ce faisant, que l’idée d'un nous, seul et absolu comme fusion, est rendue impossible.
Jean-Luc Nancy rejoint le rejet de Jacques Derrida d'une communauté fondée sur l’identité confondante et confondue du collectif, mais il rejette également toute suffisance derridienne de l’individu.
Il n’en demeure pas moins, pour Jacques Derrida, qu’il y a chez Jean-Luc Nancy, comme chez Maurice Blanchot d'une autre manière, un indépassable et regrettable horizon de communauté. D’un autre type certes, mais qui reste toujours une communauté. Il pourrait ainsi prendre au mot Jean-Luc Nancy contre lui-même, lorsqu’il évoque l’idée d’une commune appartenance au monde de la solitude. Oui, dire que nous n’appartenons à rien, c’est toujours appartenir à ceux qui n’appartiennent pas, c'est toujours dire nous. Dire : « nous les solitaires », c’est toujours dire nous pour Jacques Derrida qui rejette l’appartenance pour préférer les convergences et les contiguïtés. La grande difficulté de Jean-Luc Nancy tient donc en ce qu’il cherche à penser un au-delà de l’être-avec fragmenté derridien, tout en refusant un être-commun essentialisé, avec sa propre existence autonome vis-à-vis des existences singulières. Reste pour Jacques Derrida que dire qu’il n'y a rien entre nous, exprime toujours déjà un nous figé, même dans la médiateté du rien. Certes, il y a pour nos deux philosophes, la pensée d’une éventuelle semblance et d’une possible dissemblance, mais pour Jacques Derrida elle ne doit pas se dire au risque de se ré-institutionnaliser et de se ré-identifier. Jacques Derrida, recherche cet espace où semblance et dissemblance restent là, en suspens et floues. Côte-à-côte, chacun s'y tient en amont de l’une et de l’autre. C’est l’espace tout à la fois dis/semblable de la différance : la conjointe possibilité de l'une et de l'autre.
Ce que révèle cette indépassable difficulté du semblable dans l’énonciation du nous, tient au processus-même qui lui est intrinsèque : la délimitation et conquête d’un soi. Le nous accorde, en effet, au pluriel l’activité auto-appropriante du je sur lui-même : passant du moi-même au nous-mêmes — si ce n’est au nous-même sans plus de « s ». Il s'agit d'une quête de souveraineté absolue comme le montre Jacques Derrida. Dans le cadre de l’exemple politique français, le philosophe reconnaît que le je monarchique, définissant l’identité nationale par son nous de majesté, a laissé place à un nous auto-élaboré par le peuple en ses divers représentants nationaux. Cela-même pourrait laisser à penser que le nous se soit ouvert… En réalité, ce nouveau nous reste toujours empreint de cette semblance figée qu’il appelle intrinsèquement. Et ce, non du fait de tel·le ou tel·le acteur·ice le définissant, mais du fait même de le définir quel que soit le ou les acteur·ices. Entre la monarchie et la république, l’élaboration du nous a quitté le champ de l’un seulement pour rejoindre celui du plusieurs. Il ne s’est pas délesté de l’ambition souveraine, qui n’est autre qu’une fabrication d’une identité propre — qui s’est épuré de toute saleté, de toute prétendue « anormalité ». Pour reprendre Jacques Derrida (2008), avec la mort du Roi s’est bien opérée une révolution de la souveraineté, transférée au peuple, mais non une rupture avec la rigidification souveraine. Cette dernière est encore dépendante du complexe mytho-théologico-politique — d’autant plus dans le cadre de l’Etat de par son essence religieuse. Le nous habite donc le plan du savoir, de la re-connaissance, et plus précisément de ce que Jacques Derrida présente comme un dispositif intrinsèquement souverain de savoir-pouvoir-voir. L’écart est donc bien perceptible sur ce point entre les deux amis philosophes. La méfiance du premier étant peut-être plus grande encore vis-à-vis de la souveraineté, et de ce que le nous peut en nourrir le gêne absolutiste.
L’hégémonie du nous sommes frères
Le problème consiste donc en la maîtrise du commun de ce nous lors du passage du singulier au pluriel. Et ce, par l’intermédiaire du discours performatif, c'est-à-dire du récit que le nous élabore en même temps qu’il s’institue lui-même. Un des exemples de ce récit prend les traits de la fraternité. Un thème sur lequel divergent, par extension, Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy. En effet, l’un des supports favorables à l’élaboration d’une telle fixité du nous, réside dans la famille et la relation fraternelle en ce qu’elles participent de schèmes et récits signifiants et unifiants. Jacques Derrida s’oppose ainsi à la fraternité quand son ami arrive à s’en accommoder.
Ce qu'il faut retenir, c'est que de la fraternité, Jacques Derrida critique ladite mytho-théologico-cosmologisation doublée de virilisme et de souverainisme. Il en dénonce ainsi le logocentrisme, et plus encore son phallogocentrisme : la monopolisation par le mâle d’une parole qu’il institue en modèle de référence, excluant, de fait, la femme et la sœur. Jacques Derrida souligne ainsi combien la politique, en tant que communauté ou en tant qu’État-nation, est emprunte du modèle paternaliste. En effet, les frères le sont devenus par reconnaissance institutionnelle de leur appartenance à la famille. Ils sont des alter ego ayant en partage un ego ascendant — parfois porté en transcendance — accordé au pluriel du nous familial : celui du père. Le père, qui, par sa parole, sa re-connaissance exerce cette souveraineté discursive absolue. Celle qui institue l’identité en-commun de l’ensemble, et fait de l’enfant une simple partie du tout familial, et n'existant que par et d'après le tout— résonne ici l'œdipianisation de la société que décortiquent Gilles Deleuze et Félix Guattari (L’Anti-Œdipe, 1972). Or, cette autorité portée en héritage, de génération en génération, tout au long d’une filiation, s’impose aux descendants contraints de tenir les frontières établies de ce nous quitte à s'en rendre malades — et, au mieux, de le faire dominer tout autre discours. Il y a donc dans la discursivité, un processus d’unification renforcé par la différenciation, en négatif, de ce qui n’est pas nous, de ce qui n’est pas membre de la famille, du res-semblable, de l’ego originel du notre père.
Jean-Luc Nancy souligne, avec son ami, le besoin incontournable d’auto-fondation, au présent, de l’être-avec que requiert une démocratie démocratique, non théologico-politique et à rebours d’une fondation passée et héritée.
Toutefois, pour sa part, il ne jette pas le bébé fraternité avec l'eau du bain paternaliste.
En déplaçant l’instance d’autorité et de filiation, il pense une ouverture dans la fraternité au travers d’une matrilinéarité. En opérant cette translation, il extirpe la relation fraternelle de ses étymologies indo-européenne (bhrater) et latine (frater) liées au père au bénéfice de la néonymie grecque de l’antiquité (adelphos) liée à la mère. Chemin faisant, la filiation échappe à la reconnaissance souveraine et contraignante du père. Il ne s’agit d’ailleurs plus tant, pour Jean-Luc Nancy, de relation entre frères, ceux-ci se rapportant étymologiquement et conceptuellement au père, mais de fils et de filles d’une même mère entre eux : « Les fils et les filles sont moins ceux qu’unit le sang... que ceux qu’unit la communauté de l’allaitement, (...) le don externe, discontinu et médiat d’une substance nutritive » (Nancy, 2011. texte destiné à la publication en Turquie). La communauté, cet entre nous nancéen, ce en-commun relève alors du nourrissement, de l’allaitement, de la matrice substantielle, matérialiste, et non discursive, idéaliste.
Ce faisant, Jean-Luc Nancy prétend expanser la fraternité dans la sororité, qui pourrait être une forme de cet « au-delà de la fraternité » qu’appelle Jacques Derrida.
Si Jean-Luc Nancy est le premier à reconnaitre lui-même que le terme de fraternité est insuffisant, il y voit toutefois la possibilité d’un horizon, une fois « sororisé ». Il déclare ainsi : « Si ‘liberté’ et ‘égalité’ représentent – à condition d’être toujours repensées – les conditions minimales d’une association civile sans fondement donné, ‘fraternité' peut indiquer l’horizon de ce dehors du socio-politique ».
Cependant, cela ne résout pas davantage, en réalité, les dangers de la fraternité même en tant qu’horizon. Dans cette re-conception nancéenne de la relation entre fils et filles, la souveraineté discursive et l'identité de sens semblent seulement s’effacer, car l'interprétation discursive n'a jamais été le propre des idées. Elle peut idéaliser et raisonner une expérience matérielle. Pour autant, les événements historiques ont montré combien il était possible d’élaborer un sens commun, une identité commune, même une fois la figure du père achevée. Aussi, la nation et la patrie françaises et révolutionnaires, empruntent-elles cette voie-même, pour ne pas dire cette même voix, qui porte en elle une autre discursivité souveraine du nous à partir de la terre, du nourrissement, de la matrice et non plus du roi-père. L’on retrouve ici, la même observation derridienne. De même qu’à la Révolution, la souveraineté et le dispositif du savoir-pouvoir-voir n’ont pas été abolis mais transférés du monarque au peuple, chez Jean-Luc Nancy le support du récit, d’un nous souverain, semble s’être seulement déplacé du ciel-esprit-père à la terre-matière-mère. En effet, la logique de droit du sol qui correspond à la filiation symboliquement maternelle, par la mère faite terre, ouvre le nous pensé seulement par le lignage paternel. Toutefois, il peut tout aussi bien se refermer par interprétation, dans un clivage de ceux nés sur une « même terre » et ceux qui y seraient étrangers. Pour mieux comprendre cela, il me suffit de reprendre celle qui est prise pour l’exemple-même de la démocratie : l’antique Athènes. Un texte de Platon met en lumière le vrai complexe qui se noue dans l’association de la fraternité et de la démocratie. La politique démocratique athénienne est en effet caractérisée par la mise en système de trois égalités : iségorie, isonomie et isogonie. C’est le rapport de l’isonomie et de l’isogonie qui intéresse ici. Les athéniens, sous le terme d’isogonie, pensent une égalité de naissance délimitée par l’appartenance, du fait de la naissance, depuis une même terre. Ils pensent, en somme, une égalité entre autochtones qui exclut le metoikos. Il y a donc là, au fondement de cette isogonie, la logique d’un héritage commun constaté qui délimite la terre. C’est donc un fait qu’un autochtone constate à sa naissance et qu’il entretient en l'héritant ou qu’il « trahirait » en ne le respectant pas. Or, toute la tension réside dans ce que l’isogonie implique l’isonomie ainsi que le développe Platon dans le Ménexène (2). L’isonomie constitue l’égalité devant la loi et le droit. Cette égalité est, certes, induite par l’isogonie, elle en est la reconnaissance et l’institutionnalisation juridique et politique, mais elle est dans le même temps conditionnée par cette dernière. L’égalité de droit est prise dans le respect que requiert l’héritage fondé avant-soi, par les toujours déjà morts.
Vient donc poindre ce que la fraternité nancéenne, toute aussi sororisée soit elle, ne cesse d'avoir pour limites : la souveraineté discursive du nous, instituant le semblable et l’identique, et ce faisant le mesurable et comparable.
Ce que Jacques Derrida lui reproche sur ce point, tient bien à conditionner, dans la communauté et la fraternité, la liberté d’être soi à l’égalité de naissance. Il voit donc comme impossibles ces mots de Jean-Luc Nancy : « La communauté partage la démesure de la liberté » (L’expérience de la liberté, 1988 : 97). Il voit bien au contraire dans le fondement de la liberté sur l’égalité mesurable, une conditionnalisation de la liberté entre les fils et filles, ce « partage de la liberté » entre « égalité, fraternité, justice » qui sert de nom à l’une des parties de l’ouvrage de Jean-Luc Nancy sur L'expérience de la liberté.
Ce système entremêlant récit, mythe fondateur et souveraineté questionne donc en profondeur la démocratie et l’être-avec. Une démocratie du lignage, où la seule liberté est celle du semblable, semblable au nous souverain fraternitaire. Une liberté refusée à l’autre radicalement autre, et non alter ego par l’égalité fondatrice de la naissance, par ascendance et transcendance.
Nous voyons ainsi combien Jacques Derrida, à l’inverse de Jean-Luc Nancy, réfute l’idée politique de fraternité pour ce qu’elle porte et supporte en elle ce processus d’auto-appropriation du nous-même, de cette ipséité qui exclue le dissemblable : l’autre.
Et ce, même dans la démocratie telle que nous la connaissons aujourd’hui prise dans un État-nation. Or, comme le souligne Jacques Rancière, selon Derrida, « l’essence de la politique est la souveraineté, laquelle est une idée d’origine théologique. La souveraineté est d’abord celle du Dieu tout-puissant. [...] Dans cette perspective, le concept de dêmos ne peut avoir aucune spécificité. Il se rapporte au concept d’un sujet souverain autodéterminé, homogène à la logique de la souveraineté qui soutient les États-nations » (Rancière, La démocratie est-elle à venir ?, 2012 : 163).
Le problème politique
Le nous implique, de fait, un récit performatif, instituant la souveraineté sur soi, et de fait la séparation de l’autre. Mais ses conséquences, et leur concrétisation, lui sont-elles, et à lui seulement, imputables ? Il n'est pas inintéressant de constater que Jacques Derrida comme Jean-Luc Nancy, remettent en question l'être-avec dans son cadre politique pour en constater les possibilités et implications aux frontières ou hors du champ politique. En effet, Jean-Luc Nancy suit également ce cheminement, ce qui rendrait, dans un premier temps, caduque la critique de Jacques Derrida à propos de la fraternité, notamment, et de l’articulation de la liberté à l'égalité fondée dans la naissance depuis une même matrice. Il faut bien souligner que lorsque Jean-Luc Nancy déclare que la fraternité peut faire signal, constituer un horizon, il précise bien qu’elle « peut indiquer l’horizon de ce dehors du socio-politique ». Il est donc question d'un dehors du politique. Toutefois, il n'en demeurerait pas moins pour Jacques Derrida que la fraternité même hors du politique est à dépasser.
Toujours est-il que les deux philosophes ont en partage cette volonté de penser l’être-avec en dehors des limitations du cadre politique — sans pour autant qu'il en soit absolument délié.
Il y a pour Jacques Derrida une aporie du politique, entre sa possible volonté d'ouverture et sa souveraineté récitée délimitant le hors frontière, le dissemblable. Or, le politique est intrinsèquement une entreprise souveraine d’un je singulier monarchique, tyrannique ou bien d'un je pluriel, d'un nous généalogique ou généa-démocratique. Je ne dis pas démocratique car si le nous était véritablement démocratique alors il ne pourrait s’institutionnaliser, se figer, se définir de manière stable et pérenne.
Il n'y aurait pas lieu d'avoir quelque nous que ce soit. Il ne pourrait à la limite y avoir un nous que comme un peut-être : peut-être-nous, nous-peut-être. Au contraire, j'évoque donc bien une généa-démocratie en ce qu’il y a cet enracinement de la démocratie dans un terreau filial fraternel et paternel. Avec Jacques Derrida, il s'agirait donc de penser le politique hors de la communauté, que porte le nous, et, ce faisant, de penser le politique hors de sa souveraineté. C'est ici-même que réside l’aporie du politique. Jean-Luc Nancy, à l’inverse essaye de penser la communauté hors du politique, comme un infra-politique. Mais ce faisant, aux yeux de Jacques Derrida, il ne quitte toujours pas véritablement le complexe mytho-théologico-politique pour penser un complexe purement éthico-politique. Aussi, selon Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy trouverait-il à penser la communauté que celle-ci devrait être in-instituée, plutôt que d'être inavouable ainsi que l'a décrite Maurice Blanchot (Leroux, 1995 : 113). Bien que Maurice Blanchot se soit attelé à une lecture de son ami Emmanuel Levinas et de sa pensée éthique, il n’en demeure pas moins qu’apparaît impossible l’équation entre la communauté et la responsabilité éthique vis-à-vis de l’autre radicalement autre. Maurice Blanchot fait, en effet, du transcendant, c’est-à-dire du nous comme fusion, que critique Jean-Luc Nancy également, le support de l’autorité discursive collective. Ceci implique comme le souligne Jacques Derrida, une anesthésie des conditions essentielles du renversement éthique levinassien qui se pense comme accueil de l’hors-communauté, du visage, de l’inconnu, de l’imprévisible et du non calculable. Cela étant antinomique avec le nous communautaire.
Cependant, Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy ne reprennent pas absolument pour leur compte la pensée d’Emmanuel Levinas. Ce qu’ils retiennent tous d’eux de ce dernier, tient dans le renversement éthique qu’il a fait subir à la phénoménologie, face aux conséquences de la révolution ontologique de Martin Heidegger. Mais ils refusent l’extériorisation de l’éthique hors du politique préférant le champs de l’infra-politique pour Jean-Luc Nancy ou de l’hyper-politique pour Jacques Derrida — d'un politique dé-souverainisé, dé-mythologisé et dé-théologisé en ce qui concerne ce dernier.
Ainsi, Jacques Derrida appelle-t-il à une conversion éthique du politique, qui l'est déjà pour partie de par les questions d’hospitalité notamment — que Levinas quant à lui sortait du politique.
Le philosophe de la déconstruction pose ainsi un « au-delà-dans » (3) du politique jouant de la formule d'Emmanuel Levinas pour en dépasser le clivage éthique/politique. Cette déconstruction du politique derridienne s’oppose à la pensée de Jean-Luc Nancy, qui, nous l’avons dit, ne souhaite pas abandonner la notion de communauté. Ce faisant, il semble en permanence retenu par la discursivité institutionnalisante du nous interne au politique et que Jacques Derrida déconstruit. Il y aurait donc chez Jean-Luc Nancy, selon Jacques Derrida, une aporéticité entre un politique construit de l’égalité conditionnée, du comparable, et, de l'autre côté, une éthique pure asymétrique, imprévisible et inconditionnelle. Tout l'enjeu est donc pour Jacques Derrida de penser le politique et son origine là où l’Un-principe se divise et diffère contrairement à un politique fraternel fondé sur l’unité et l’homogénéité. L'origine politique n’est donc plus chez Jacques Derrida homogène mais hétérogène, elle est un infini ouvert et non une totalité close. Aussi, si Jean-Luc Nancy aspire à s’affranchir de l’origine totalisante en libérant le nous du récit mythique, la communauté resterait toujours appelée, à défaut, à un horizon commun, tout aussi totalisant qu’une origine homogène. Tout l'enjeu est donc que la communauté ne semble pas parvenir à s’affranchir du règne de l’homogène, qu’il soit originaire ou tenu pour horizon retrouvé.
Jean-Luc Nancy reconnaît cette difficulté de la communauté de ne pas se fonder sur un mythe lorsque celui-ci est achevé, sinon sur un récit du mythe perdu qui devrait être retrouvé.
Il développe ainsi : « Rien n’est plus commun aux membres d’une communauté, en principe, qu’un mythe, ou un ensemble de mythes. Le mythe et la communauté se définissent au moins en partie – mais c’est peut-être en totalité – l’un par l’autre, et la réflexion sur la communauté appelait à être poursuivie du point de vue du mythe » (Nancy, 1986). C'est là toute l’aporie que souligne Jacques Derrida derrière l’ultime recours par Jean-Luc Nancy de la formule « la communauté de ceux sans communauté ». Pourtant, Jean-Luc Nancy s’essaye à penser la possibilité d’une communauté sans mythe, auto-fondée, une communauté de l’hors de soi. Où le mythe ne survit pas dans l’horizon d'une reconnaissance.
Il me faut rappeler que Jean-Luc Nancy prend pour point d’appui, tout en s'en distançant, les réflexions de Georges Bataille. Or, ce dernier refuse, devant son impossibilité, la quête d'une communauté politique. Il préfère ainsi retrancher la communauté en deçà du politique, au rang de l’intime dans ce qu’il nomme la communauté des amants. Cette communauté s’oppose à une société d’acquisition et d’appropriation souveraine de soi qu’est le politique étatique et mythologique. Nous voyons donc que le terreau sur lequel s'appuie Jean-Luc Nancy avait déjà pensé la difficulté d'une communauté en-deçà du politique, tout en conservant la même échelle et étendue. Et ce, en se trouvant appelé à une réduction de l’espace communautaire autour des amants. Par suite, Maurice Blanchot, sur lequel travailla Jean-Luc Nancy, propose quant à lui trois niveaux distincts de communautés complétant le plan intime posé par Georges Batailles. Il cite la communauté des amants, de l’amour, puis la communauté de l’amitié et enfin la communauté politique (qu’il observe lors des événements de Mai 1968 à travers la figure du peuple). Toutefois, Maurice Blanchot reste très ancré sur la communauté des amants, dont il trouve un symbole dans l’œuvre de Marguerite Duras : La maladie de la mort. On voit donc une tendance à la pensée d’une communauté politique négative soit chez Georges Bataille soit chez Jean-Luc Nancy qui reprend l’idée d’une communauté comme communication des passions mais qui, pour sa part, la pense irréductible aux amants. Toutefois, il ne pense pas de la même manière cette expansion au-delà de l’intime que Maurice Blanchot. Ce dernier lui reproche une telle conceptualisation d'une communauté politique négative. Sur cette distance, Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida se retrouvent, mais ils se distinguent sur leurs pensées propres du politique. Alors que Jacques Derrida assume la responsabilité de la fragmentation, de la sortie de la parenté, de l’oikeiotes (Derrida, 1994 : 53) contre la totalisation, et l’homogénéisation, Jean-Luc Nancy voit lui un des grands mots de notre temps dans cette fragmentation.
Le temps de penser à soi comme à un·e autre
Ce qui marque également la relation de pensée de Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy sur le politique et le nous, c’est une pensée du retrait du téléologique et du finalisme. Jacques Derrida s’est toujours placé en défaut d’une linéarité historique, et d’une fin de l’histoire telle que théorisée par Fukuyama notamment. Jean-Luc Nancy voit également dans l'histoire une ouverture plutôt qu’un accomplissement et reconnaît, dans sa propre pensée, l’influence de la pensée derridienne sur ce point. Cette pensée de la temporalité, en contre-temps et diffractions, Jacques Derrida l’opère au rang premier de l’individu, du je dont le schème discursif est support du nous. En effet, le problème du politique et de la communauté réside dans la conjonction de leur souveraineté et de leur temporalité. Celles-ci étant perçues comme entéléchies et accomplissements de sens unifiés et homogènes préservés par le nous. Il faut donc pour Jacques Derrida comme pour Jean-Luc Nancy sortir de la souveraineté et de sa temporalité entéléchique. Celle-là même qui fait courir le risque de l’universalisation comme résolution et résorption du cosmopolitisme, de l’uni-multiplicité contre l’unité. Pour cela, Jacques Derrida s’appuie sur la pensée de Paul Celan dans son livre Le Méridien qu'il cite dans son propre ouvrage La bête et le souverain. Ce que donne à penser Paul Celan, est l’impossibilité d'un au-delà du souverain à l’intérieur du cadre ontothéologique, mytho-politique.
L’au-delà de la souveraineté indivisible appelle à un dépassement de l’ontologie heideggérienne et de la théologie chrétienne dont nos formes politiques sont les héritières.
Jacques Derrida retient de la révolution célanienne un détachement du dispositif savoir-pouvoir-voir, ouvrant à la discursivité démocratique du peut-être et de l’imprévisible. Ouvrant à la discursivité d’une politique dont l’origine est hétérogène comme décrite en amont. Paul Celan dresse ainsi une topographie du je, que nous pourrions appliquer au nous, répartie en trois catégories : 1) le je politique et souverain dans la continuité de la monarchie et de son leg à la République démocratique fraternelle ; 2) le je poétique et ontologique étendant la souveraineté à l’universel ; 3) le je au-delà du souverain, à la fois politique et poétique, symbolisant une étrangeté à soi, une ouverture à la présence de l’autre. Dans ce que Paul Celan nomme le poème absolu, et qui fonde la pensée de Derrida sur ce point, il y a une rencontre de différentes temporalités, si ce n'est d’un même temps propre qui se diffère. Une différance derridienne comme un palimpseste du je déconstruit et fragmenté.
Un je qui cesse d’être souverain pour devenir un « qui ? » en passant d’un schème ontologique à un schème éthique.
Un tel je devenu « qui ? » requiert, en effet, un Tu qu'il n’exclut plus car le « je-qui ? » (le je se rappelant toujours qu’il ne peut jamais répondre au qui-suis-je ?) ne se rencontre que dans la sortie de soi et la rencontre de l’autre. Il découvre une autre lecture de lui-même dans le regard de l’Étranger. C’est ici-même que se noue cet « au-delà-dans » déridéen du politique, dégager de tout système général d’équivalence et de comparabilité dans le savoir. Jacques Derrida joue donc d’une arythmie de la pensée et de la discursivité identitaire du je. Il joue de la dissonance, du désaxement et du désaccord que permet la fragmentation et que refuse Jean-Luc Nancy. Ce mouvement du contre-temps est, en effet, fondamental chez Jacques Derrida notamment à travers la différance qu'il théorise comme cette insurmontable latence de soi à soi.
Lorsque le je ou le nous se dit, il passe déjà à côté de lui-même et n'élabore de fait qu'une fable sur lui-même.
Ce même récit que j’ évoquais justement en politique plus en amont. Jacques Derrida déconstruit donc le je qui, dans la structuration de l’identité, est constitutif du rapport ami-ennemi pensé par Carl Schmitt et contesté dans Les Politiques de l’amitié.
Jean-Luc Nancy quant à lui, hérite également de la pensée de Bataille et de Blanchot comme nous l'avons dit. Maurice Blanchot pense également une discontinuité, un désajointement mais pas semblablement à ce que Derrida proposera à l’intérieur-même du je et à une échelle politique. Pour ce dernier, il y a désajointement dans la communauté des amis pour exemple. Il évoque ainsi « une amitié sans partage comme sans réciprocité, amitié pour ce qui passe sans laisser de traces, réponse de la passivité à la non-présence de l’inconnu » (Nancy, 1980 : 47). Voilà retrouvée la rupture de réciprocité qu’implique le renversement éthique de Levinas et dont hérite Derrida. Cependant en échappant à la fragmentions du je lui-même, la distance que reconnaît Maurice Blanchot n’abolit pas le fondement identitaire, homogène et égalitaire de l’amitié telle que pensée par Carl Schmitt et la tradition. Aussi, n’est-il pas anodin que Jacques Derrida reprenne dans ses Politiques de l’amitié, ces mots de Maurice Blanchot lorsqu’il écrit que nos amis « réservent, même dans la plus grande familiarité, la distance infinie, cette séparation fondamentale à partir de laquelle ce qui sépare devient rapport » (Blanchot, 1971 : 328-329). Mais que, pour autant, il demeure toujours l’enjeu du nous et de la communauté instituée que ne remet pas en cause Maurice Blanchot quant à lui. D’autant plus que, comme nous l’avons vu, Maurice Blanchot n'étend pas à l’être-avec politique cette pensée de la rupture de réciprocité. Tout l’effort de Jacques Derrida est de ne pas voir l'amitié comme un espace restreint mais bien le support d'une politique « au-delà-dans » du politique. Une amitié plus grande que la loi, architectonique à la loi. Une hyper-politique de l’amitié inspirant la politique. La rupture d’égalité, du calculable dans la semblance ne se fait pas hors du politique contrairement à Maurice Blanchot qui sépare la communauté des amis et la communauté politique.
Aussi, y a-t-il tout en nuance une pensée de la distance dans la relation interpersonnelle. Jacques Derrida la pense spécifiquement sous les traits du poleros : cette friction entre le polemos et l’eros. Dans l’eros réside l’aller vers l’autre, et dans le polemos réside la préservation des singularités contre le nous fusion. En effet, le polemos est ici interne à l’eros et l’amitié contrairement à l’association du freund et de kampf chez Heidegger qui peut mener à la constitution unifiée d’un nous dans le combat face à l’extériorité dissemblante et ennemie. Derrida, lui insuffle la possibilité de la dissemblance à l’intérieur-même du philein à rebours du type d’amitié lié à la citoyenneté dans la Grèce antique. Il y a donc chez Jacques Derrida, au contraire de la pensée de la communauté et de l’être-en-commun, une préservation démocratique des antagonismes afin de lutter contre tout équilibre qui serait à même de fonder une linéarité historique et une marche politique entéléchique. Contre Maurice Blanchot, il y a chez Jacques Derrida la mise en lumière de ce que, du politique, « le premier paradoxe ou l’aporie principielle tient au fait que l’expérience de la dissociation ou de l’hétérogénéité disséminale est cela même qui interdit la dissociation de se fixer ou de s’apaiser en distinction oppositionnelle, en frontière décidable et en différence rassurante » (Zagury-Orly, 2003). Jean-Luc Nancy est ainsi tiraillé entre la pensée de la communauté et la pensée de la différance, de la rupture hétérogène qui appelle la fragmentation qu’il souhaite pallier pour sa part. Ce qui distingue donc Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy tient à ce que la révolution célanienne de Derrida, fondant, par une dé-souverainisation, une illéité et son peut-être, appelle à un retrait du politique. Retrait en lui-même extrêmement politique, car relevant de cet hyper-politique, cet « au-delà-dans » du politique par conversion éthique du politique-même. Aussi, cette sphère de l’hyper-politique, comme le développe Jacques Derrida dans Voyous (2003 : 210), s’abstrait-elle de l’économicité, de la réciprocité, de la dette et, ce faisant, d’un savoir ayant pour objet du calculable et du comparable.
L’hyper-politique devient l'espace du don, de l’inconditionnel qu’empêche la pensée d'une égalité de naissance sous un nous conditionnant la liberté.
Elle se place enfin hors du dispositif savoir-pouvoir-voir, en tant qu’elle est caractérisée par une passivité, un accueil de l’imprévisible, de l’infini, de l’évènement de l'autre et de sa surprise. On perçoit bien ici l’héritage levinassien de Jacques Derrida pensant la vertu de la disproportion et de l’asymétrie. Ce qui mènera Jacques Rancière à affirmer que le politique chez Derrida relève de l’aporéticité de l’heteron, du dissensus, de la justice prise dans l’asymétrie d’éléments in-substituables.
Ce qu’il reste à venir de nous
Il y a chez Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy, dans la continuité de cette pensée de la temporalité, une pensée de l’a-venir, de l’horizon de pensée, qui peut nous faire penser à l’aïôn deleuzien en tant qu’au-delà temporel idéal, et immanent au temps chronologique du concret. Dans sa Logique du sens, Gilles Deleuze le pense ainsi : « toute la ligne de l’aïôn est parcourue par l’instant [chronologique et concret], qui ne cesse de se déplacer sur elle et manque toujours à sa propre place » (Deleuze, 1969 : 195). L’aïôn deleuzien est donc, proche — seulement proche — de l’à venir derridéen, un « infinitif : aiôn illimité (...) toujours esquivant le présent » (Deleuze, 1969 : 14). La communauté pose en effet, cette ambition entéléchique et finaliste d’accomplissement de son horizon commun ou de son origine commune.
Cela, Maurice Blanchot l’avait bien saisi déjà et avait proposé un désœuvrement pour avorter de la communauté cette tendance entéléchique. Blanchot questionne ainsi la possibilité du sens lorsqu’il est détaché des mythes et récits.
En prononçant le désœuvrement, Maurice Blanchot empêche cette mise en œuvre du nous dont les totalitarismes font oeuvre.
Comment Blanchot opère-t-il ce désoeuvrement ? Pour le symboliser, il reprend le récit de son amie Marguerite Duras intitulé La maladie de la mort. Lorsque Maurice Blanchot parle de désœuvrement, et, ce faisant, d’œuvre à éviter, il ne faut pas oublier qu’il a en mémoire la définition catholique de l’œuvre. Celle-ci est, en effet, liée dans les dix commandements à la communauté du mariage et désigne l’œuvre de chair, c’est-à-dire le rapport sexuel. Blanchot trouve dans le texte de Duras une sortie de l’œuvre de chair maritale. Il n’est, en effet, pas inintéressant de constater que le terme coït se définit étymologiquement (co et ire) par le fait d’aller ensemble, de se réunir, se fondre. Une étymologie commune à la notion d’assemblée délibérative (coetus). Maurice Blanchot trouve donc dans La maladie ou la mort un amour sans retour et avant toute chose : sans recours. Il y a un rapport sexuel sans rapport amoureux qui semblerait donc défaire le rapport sexuel d’une logique de fusion. Toutefois, ce que souligne Jean-Luc Nancy, il trouve tout de même dans cet exemple une communion presque christique, Blanchot comparant le corps de la femme du récit au corps eucharistique offert en partage. Maurice Blanchot reprochera ainsi à Jean-Luc Nancy d’avoir manqué l’effectivité de la communauté infra-politique, de ce don d’amour soustrait à l’affectivité. Certes, la communauté de Blanchot se redéfinit, faite de rapports, d’osmose et de porosité littéraire, mais en voulant dés-œuvrer elle suppose une œuvre de la communauté pour pouvoir l’annihiler. Jean-Luc Nancy voit donc une œuvre de la communauté dans la communion blanchotienne et son eucharistie symbolique. Le philosophe rappelle donc combien c’est le fait de vouloir que la communauté devienne une œuvre, dans sa quête d’ipséité, qui dénature la communauté infra-politique tel qu'il s’efforce de la penser. Nous retrouvons ici l’approche négative de la communauté, qui n’agit pas, ne se donne pas un sens. Mais une communauté qui est tiraillée par le rapport. Rapport que Jean-Luc Nancy questionne comme possiblement toujours sexuel. Cette tension déjà présente chez Maurice Blanchot qui, bien qu’il enlève l’attribut amoureux et fusionnel à l'image du récit, désigne bien un moment d’union. Or, Jean-Luc Nancy, à partir de cette communauté comme œuvre, dont il appelle à s’extraire, souligne combien elle sert de linéaments à Rousseau, Hobbes, Bodin ou encore Machiavel et leurs communautés se comprenant comme entité politique (état, état-nation) se produisant elle-même dans le temps présent et le concret. Il y a en effet, dans la réflexion sur la souveraineté, une théorie de la puissance supérieure à toute autre puissance allant à l’encontre de cette pensée du recul, du retrait, de l’accueil et de la passivité donnée à penser par Jacques Derrida. Une souveraineté permise par l’accomplissement, la réunion du semblable et qui s’exprime jusque dans la communauté des amants. Une communauté est pétrie du fantasme amoureux de l’unité retrouvée tel que donné à lire dans un des discours du Banquet de Platon, ou encore dans Tristan et Yseult. Le fantasme des amants, baignant dans le rapport sexuel, l’œuvre de chair, et qui s’imprime comme fantasme politique d’unité semblablement souveraine. Pour Jacques Derrida, il faut rompre avec toute appropriation amoureuse en rompant avec le principe d’équivalence conjugué au finalisme de souveraineté.
Jacques Derrida, affranchi du cadre de la communauté. Il pense la relation à l’autre à l'aune d'une raison à venir. Il a bien mesuré l’aporie du politique, que Jacques Rancière mit en exergue, et que constitue le règne de l’heteron, de l’au-delà-dans du politique. Malgré cette aporéticité de la conversion éthique pure du politique, de son hyper-éthique, aussi dite hyper-politique, Jacques Derrida affirme l’inconditionnalité des principes d’hospitalité, de liberté et d’amitié. Inconditionnalité pensée hors de la communauté qui par son récit d’origine commune, égale, conditionne la liberté, conditionne l’amitié au semblable et rend réticent à l’hospitalité du dissemblable pensé comme un ennemi. Jacques Derrida a, ce faisant, bien mesuré l’impossible effectuation politique de ces principes et, de fait, la réalisation de cette hyper-politique. C’est pour cela-même qu’il emploi l’à venir, cette raison à venir qui s’extirpe du temps concret, matériel et politique souverain, pour permettre de penser hors de ces frontières le don, l’incomparable et l’infini. À travers la reprise de la révolution célanienne, il rappelle combien l’au-delà du souverain ne peut se réaliser dans le chronos sinon dans l’aiôn qui reste toujours manqué par l’instant politique, par le chronos politique. C’est tout le sens de la « démocratie à venir » où tout est indéfini, et, ce faisant, échappe à l’institutionnalisation, la formation de frontières et la résorption de la fragmentation. D’autant plus grand est l’effort que fourni Jean-Luc Nancy à essayer de concilier une communauté dés-avouée avant même d’être désœuvrée, sans pour autant entreprendre la fragmentation. Il est donc lourd de sens que Jacques Derrida trouve comme espace de possibilité de son hyper-politique une phrase sans verbe conjugué dans une temporalité concrète mais avec un infinitif à réaliser : « démocratie à venir ». C’est tout le sens de ce qu’il nomme la promesse, l’a-venir d’une justice qui soit aussi dés-ajointement. La promesse est l’ouverture d’un peut-être, d’un méta-performatif en ce qu’il s’agit de laisser advenir dans une passivité et un accueil. Mais cette promesse doit voir ses fondements être entretenus. Jacques Derrida s’écarte donc de Jean-Luc Nancy pour affirmer son hyper-politique, son au-delà-dans du politique qui s’extrait de la fraternité, du partage, du système d’équivalence générale et du raisonnable.
Conclusion
Aporie, hyperaporétique… voilà les mots qui semblent revenir en leitmotiv, tout au long de ce retour sur leur relation philosophique. Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy se rapprochent donc par leurs pensées du rapport à l’autre, certes, mais plus encore leurs pensées de l’extra-singularité. Pour Jean-Luc Nancy, toute l’ambition réside dans l’hors de soi. Pour Jacques Derrida, toute la difficulté réside dans le non-soi-même, le jeu littéraire de la fragmentation du je. Avec ces deux philosophes, ce sont deux pensées qui s’accompagnent, se côtoient, s’éloignent, se contredisent. Deux pensées qui se pensent et pansent leurs failles respectives. Jean-Luc Nancy redoute la fragmentation et s’essaye à faire émerger une réflexion de la communauté sans recours à la fragmentation absolue. Jacques Derrida abhorre la communauté et s’essaye à déclore l’origine même du nous, c’est-à-dire : le je souverain, phallogocentrée et théologico-politique. Entre nos deux philosophes, c’est l’histoire d’une respiration, d’une éclosion de l’être-avec : plus ou moins être et, dès lors, plus ou moins avec.
Il n’y a rien entre nous, repris-je en début d’article. Un rien du tout, qui déjà risque l’institution du quelque chose qui n’est rien. Un rien d’un il y a : comme un il était une fois, une part impersonnelle en chacun, à même de fonder une référence en commun. Un hors de soi qui pourtant participe déjà d’une quête d’un autre soi-même. Non plus le moi, mais l’entre-nous-même. Un il y a, neutre et partagé, transcendant l’immanence plurielle des corps. Entre nous. C’est ici que l’on entre dans la pensée de Jean-Luc Nancy après et pendant Derrida. Un entre nous qui ouvre le nous, dépasse son auto-suffisance et qui pourtant semble pouvoir annoncer l’antre d’un autre nous à nouveau souverain de lui-même. L’entre comme une fissure, un écart où s’insinue la question de l’horizontalité du rapport. Celui d'une communauté sortie du mythe, ne pensant pas sa fin ni son passé — sans les oublier — mais bien son présent. Celui d’une communauté sortie de la généalogie, ne pensant pas son œuvre mais la co-présence immanente de ses membres. Et déjà sonne le retour du membre et du semblable ? Qui est le nous de l’entre nous ? Et déjà, la voix de Derrida qui n’appelle ni le nous, ni le vous, ni le dedans, ni le dehors mais l’infini a-total. L’écho révolutionné de Levinas qui n’appelle plus tant un Autre défini, et dont nous serions certain, qu’un autre inconnu : peut-être semblable, peut-être dissemblable, ce que nous ne saurions jamais.
En somme, entre Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy se noue le questionnement des implications politiques de l’entrelacs du même et du tout autre... pour reprendre la formule du premier.
— Edouard MAUMONT
| NOTES
(1) Je rappelle : déjà la destruktion heideggérienne est très exactement définie (Heidegger, 1927 : 22) comme une vigilance, une reconsidération des « expériences originales dans lesquelles furent conquises les premières déterminations directrices ».
(2) PLATON. Ménexène, 238e-239 (Trad. Louis Méridier). In : Œuvres complètes, Les Belles Lettres, V, 1re partie, 1931, p. 83-105 : « Nous et les nôtres, tous frères nés d’une même mère, nous ne nous croyons pas les esclaves ni les maîtres les uns des autres, mais l’égalité d’origine, établie par la nature, nous oblige à rechercher l’égalité politique établie par la loi, et à ne céder le pas les uns aux autres qu’au nom d’un seul droit, la réputation de vertu et de sagesse ».
(3) La formule « au-delà-dans » est tirée d'un commentaire du Talmud que Levinas reprit dans « Au-delà de l’Etat dans l’Etat ». In. : Les nouvelles lectures talmudiques, 1996
| BIBLIOGRAPHIE
AUBERT, Antoine. « Jean-Luc Nancy, La communauté désavouée », Lectures [En ligne], Les comptes rendus
BLANCHOT, Maurice. L’Amitié, Gallimard, 1971
—. L’Écriture du désastre, Gallimard, 1980
DERRIDA, Jacques. Politiques de l’amitié, Éditions Galilée, 1994
—. Voyous, Galilée, La philosophie en effet, 2003
—. La bête et le souverain, Galilée, La philosophie en effet, 2008
GROSSMAN, Évelyne. « Appartenir, selon Derrida », Rue Descartes 2006/2, n° 52
KAUFFMANN, Catherine. Derrida, lecteur de Freud et de Lacan : héritages de la psychanalyse. Philosophie. Université de Strasbourg, 2020
LEROUX, Georges. « A l’ami inconnu : Derrida, lecteur politique de Blanchot ». In; Etudes françaises, Vol. 31, No.3, 1995
NANCY, Jean-Luc. La communauté désœuvrée, Christian Bourgeois Editeur, 1986
—. L'expérience de la liberté, Galilée, La philosophie en effet, 1988
—. Etre singulier pluriel, Galilée, 1996
—. « Fraternité », 2011 (texte destiné à la publication en Turquie)
RANCIÈRE, Jacques. « La démocratie est- elle à̀ venir ? : Éthique et politique chez Derrida ». In. : Revue Les Temps Modernes. Derrida, l’évènement déconstruction, 67e année Juillet/octobre 2012, N° 669/670
ZAGURY-ORLY, Joseph et Raphaël. Judéités. Questions pour J. Derrida. Galilée, 2003.